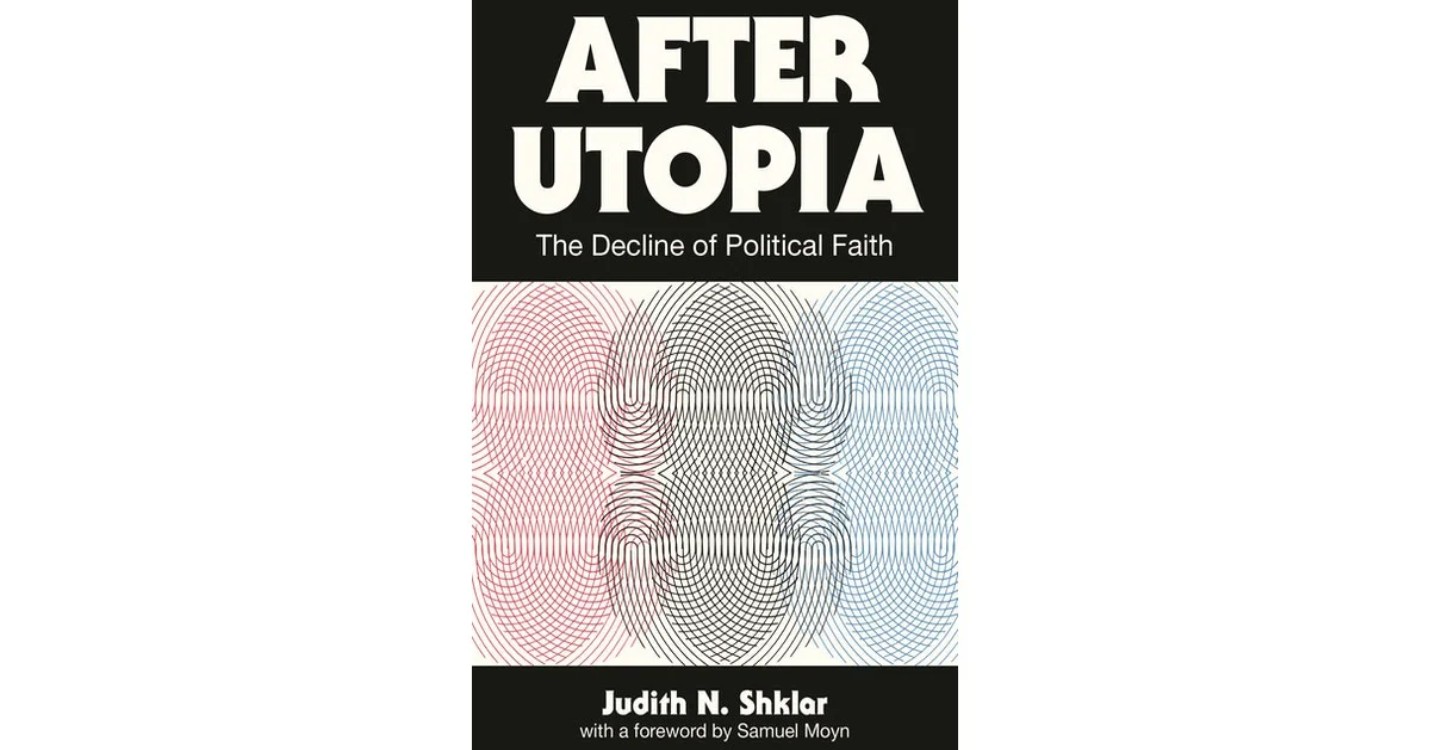Fin octobre, début novembre, à leur jointure, ces deux mois se disputent le droit de gérer la peur.
Halloween d’un côté et la Toussaint de l’autre.
Si le premier débouche sur la fraternité familiale et de voisinage bon enfant dans les cadres d’une fraternité terrestre, le second tout en traversant la fraternité familiale et celle de voisinage débouche sur la fraternité céleste. Les deux touchent à la mystérieuse présence de l’existant -pour parler en termes propres à la philosophie thomiste- aux frontières du réel que l’on constate entre la vie et la mort.
L’imaginaire nourri par des sensations suscitées dans la vie réelle permet d’y accéder parfois la peur au ventre. Enfant, pour aller à l’école j’avais le choix entre deux chemins, mais chaque fois il fallait passer devant un cimetière.
J’ai souvenir de ce passage surtout en solitaire et par temps maussade où la nuit porte la charge de la peur nourrie d’une irrésistible volonté, d’aller voir ce qu’il y a de l’autre côté.
A la peur était mêlée une sorte d’excitation que provoque la proximité avec le monde de l’au-delà, dont la réalité est nourrie des faits historiques révolus, les morts sont morts, et de l’imaginaire sur ce curieux au-delà pressenti.
L’enfant y accède par ces deux voies : l’évidence de la mort et l’inconsolable rupture qu’elle provoque d’un côté et l’irrésistible attirance pour en percer tant soit peu le mystère.
Le paysage de mon enfance est en fait marqué par les trois cimetières qui se trouvent au bord des routes, telles des boursouflures cutanées en proximité immédiate des veines d’un corps vivant mais par endroits nécrosés.
Un cimetière en souvenir du passage de la peste du début xx siècle, un autre comme souvenir de la communauté allemande présente jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Le troisième cimetière, catholique, se trouve un peu plus loin, sur la grande route, fréquenté depuis ma tendre enfance pour renouer des liens d’outre-tombe avec les ancêtres. Le seul qui donc est constamment alimenté de la présence des corps morts d’anciens vivants dont certains étaient mes voisins, connus de leur vivant.
Les funérailles qui aboutissent inexorablement à la mise en terre, les prières en famille sur les tombes des aïeux, les rencontres avec les voisins ou des voyageurs qui s’arrêtent sur les tombes de leurs proches, tout ceci constitue le tableau vivant, d’un endroit animé par sa destinée : n’être que signe d’immobilité glaçante.
Immobilité glaçante que même les célébrations de commémoration des fidèles défunts adossées à la fête de la Toussaint ne parvenaient pas à transformer la mort en lien de vie.
Une fois le lieu quitté, les tombes illuminées à la nuit tombante, telles des aurores boréales, faisaient miroiter la vie qui se communique de part et d’autre de l’existant.
Avec l’engouement esthétique pour maquiller la laideur dont l’éloignement optique faisait momentanément oublier les contours réels, la fête des morts, non sans mal, se laissait absorbée par la Toussaint.
Tout ceci constitue un vivier pour l’imaginaire et contribue à travailler le rapport au mystère de la vie et la peur qui l’accompagne. N’ayez pas peur, l’encouragement le plus fréquemment répété dans la Bible perce les oreilles des apprentis de la foi chrétienne.
Et cette missive constitue un canal par lequel faire passer l’espérance d’une vie, l’espérance dont la promesse pourrait un jour, ou plutôt une nuit, se transformer en participation active à sa réalisation.
Le temps change, les références aussi, l’imaginaire ne se construit plus sur les mêmes appuis. Halloween en est un exemple très parlant, comme parlante est sa visée, bien au-delà de la dimension commerciale.
Celle de nouer des liens entre les vivants, de façon horizontale, pour se serrer les coudes quand on en aura besoin. Une sorte d’équipe de rugby créée pour la circonstance et à l’intérieur de laquelle, confrontés aux dangers de chocs violents et de la perte de contrôle, pour s’en sortir victorieux ensemble.
La fête avec ses racines celtes et son culte des morts, ou plutôt la manière d’exorciser la mort, est une bonne piqûre de rappel pour maintenir à un niveau convenable les anticorps capables de lutter efficacement contre tout assaut de la peur face à la mort et ses corollaires.
Comment le faire en effet, sinon en poussant une telle confrontation aux limites de ce qu’est la vie. La peur au ventre pour l’exorciser, pour la désamorcer, pour lui donner une claque, et tout en tremblant, lui dire que l’on n’a pas peur.
L’enfant en a besoin, il s’y confronte par l’intermédiaire des petits bobos ou gros pépins de santé. Il frôle la mort, comme les adultes, mais à sa façon, dans sa propre vulnérabilité.
La peur permet d’y aller, rien que pour la dépasser. Y aller, parce que l’on s’imagine que derrière il y a quelque chose de réel ou juste de l’imaginaire. Mais la souffrance qui l’accompagne est toujours bien réelle et peu importe comment elle est générée.
Il y a quelque chose ou rien. Et ce n’est pas rien. Ni pour l’envisager, ni pour en statuer, et encore moins pour s’y engager, aspiré par l’une ou l’autre de ces deux voies.
Le passage à côté d’un cimetière réel ou imaginaire est obligatoire. Et la peur finit par ne plus faire peur. Jusqu’au jour où elle est réveillée pour réveiller les certitudes. Sous la poussée des événements, de l’urticaire, des pépins.
Tout cela pour trouver de petites vérités qui, cachées depuis toujours dans nos existences, s’y révèlent en plein ou en creux. Tout cela s’éveille à des occasions spéciales, provoquées par la vie. Mais de façon toujours bien réelle.
Et suivant le constat que l’on fait, surtout d’a priori, la peur qui accompagne de tels éveils s’évanouit, par moments, par endroits. Elle s’évapore avec les odeurs de bougies qui éclairent les citrouilles et ou les chapelles mortuaires de nos consciences.
Dans les deux cas, tout y est agité par le vent froid qui glace le cœur et ralentit le rythme de la vie. Tout y est agité par une lumière blafarde qui se pose nerveusement sur les paupières mi-closes des corps des vivants qui s’exécutent à affronter les corps morts passés et à venir, à le devenir.
Dans un combat corps à corps entre les vivants et les morts, tout ceci s’entremêle. Et cela n’a aucune importance la forme sous laquelle les corps morts se présentent, en décomposition inexorable ou réduits en cendres, ils exercent toujours la même influence sur nous. Celle de la nostalgie plus ou moins facilement tue, anesthésiée, en état de veilleuse, ou celle d’une flamme olympique…
Dans la seconde partie je voudrais m’attarder devant vous sur un aspect particulier de nos vies en lien avec la peur toujours. Rêver d’une politique sans peur pour que cela devienne, par moment, par endroits, une réalité et qu’elle s’étende sur toute la surface de la terre.
Une utopie d`un paradis sur terre. Un rêve ou une réalité, une lutte sans peur en faveur d’une telle condition paisible de vie est difficilement envisageable. Mais le désir qui y pousse est à prendre très au sérieux.
Je m’appuie sur le livre de Judith Shklar, une philosophe née à Riga en 1928, émigrée au Canada puis aux États-Unis. Elle développe dans son ouvrage sur « L’après-utopie » le déclin de la foi politique (After Utopia : The Decline of Political Faith, Princeton University Press, 1957).
Ce qu’elle souligne alors, c’est qu’il existe un désaveu grandissant pour la « chose » politique. Et que ce désaveu est un danger pour la démocratie. Et cela n’a pas changé depuis, ou plutôt a empiré. Si je convoque ce livre dans cette méditation, c’est par rapport à la peur.
La peur de la disparition même de la démocratie, la peur de la politique sans doute, sans scrupules, sans problème…. Et c’est là qu’il y a un problème.
La peur de ne plus avoir droit d’exprimer ses ressentis, y compris en doutant de ceux qui ont un réel pouvoir sur nous et l’exercent sans aucun doute etc. La peur de vivre dans un monde aseptisé et englué dans les interdépendances esclavagistes et englouti dans un marasme imposé par quelques-uns à tous. Nihil novi sub sole.
La futilité et le fatalisme sont deux caractéristiques du monde occidental après la seconde guerre mondiale. Les temps d’utopies sont révolus, la peur doit être gérée différemment. La gloire humaine aussi.
Le livre est une sévère critique portée à l’égard du socialisme et du libéralisme de ne pas avoir réussi à remplacer le christianisme déclinant sur la scène politique et sociale.
Car ils ont tous abandonné l’espoir, l’optimisme des Lumières, visible dans la révolution française, que caractérise l’absence de la peur, se transforme en despotisme plus ou moins “éclairé”. Perversion qui pousse même vers l’aspiration à la calamité. Fanatisme et désillusion viennent proliférer de façon naturelle sur les décombres d’une telle post-utopie.
L’aspiration vers un État garantissant à l’humain une bonne santé, dans le sens le plus large possible, reste toujours un vœu pieux. Pas plus à l’époque de la guerre froide où ce livre a été écrit qu’actuellement.
Rien ne garantit un système politique sans peur. La foi dans le progrès est aussi battue en brèche. Le champ de l’émotion reste largement ouvert dans cette attention car cette réalité est flottante. (Cf. liquid society de Zygmunt Bauman).
Le romantisme comme réponse aux Lumières est bien présent dans la société moderne où la place prépondérante est réservée à l’émotion comme gage d’authenticité et donc de vérité.
Tous les amalgames qui en résultent ont la vie aussi dure que les amalgames que l’on utilise pour colmater les trous dans les dents pour avoir un joli sourire et pouvoir bien mastiquer ce qui se retrouverait sous la dent.
En d’autres termes, comment dans ce contexte lutter contre la baisse de l’optimisme. Et contre la peur qui le remplace, proliférant pour son propre compte.
La fête de la Toussaint apporte une réponse toujours la même. On peut discuter à nouveau frais, mais on ne peut pas nier son essence.
Le Christ est ressuscité et il nous apporte de l’espérance qui dépasse toute distinction entre optimisme et pessimisme. Il se situe au niveau de l’espérance chrétienne.
La foi chrétienne est résolument optimiste, mais pour s’en convaincre, faut-il toujours et encore passer et repasser par les zones troubles de l’opacité humaine individuelle constatée et collectivement subie ? La réponse ne semble qu’être un oui.
La peur de l’avenir et déjà la peur du présent ; la peur d’être isolé, la peur de mal choisir, la peur de ne pas savoir s’adapter, la peur de ne pas avancer si on se protège trop.
Dans tout ce contexte, le dépassement se fait par l’accession à la fraternité qui se développe face à la situation de danger et de peur. Contre la peur une seule solution digne de la grandeur humaine : la fraternité et la confiance.