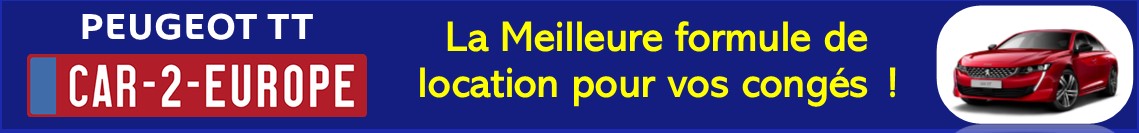Entre le 18 et le 25 janvier, chaque année est célébrée dans l’Église catholique la semaine de prière pour l’unité de chrétiens. Les dates fixées il y a cent ans, dès le début de la tradition, n’étaient pas choisies par hasard. Elles correspondent aux deux fêtes catholiques, celle de la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul le 25 janvier.
Pierre, symbole de stabilité de la doctrine chrétienne, telle qu’elle est vécue dans l’Église catholique ; Paul, l’apôtre missionnaire symbolisant l’annonce de la foi aux païens. Les deux étant considérés comme deux colonnes inséparables sur lesquelles repose l’Église avec toutefois la primauté donnée à Pierre en vertu du mandat reçu de Jésus lui-même : Pierre tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église (Mt 16,16)
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une bonne occasion de reprendre ce thème déjà traité ici-même. Dans mes diverses activités en France, j’ai aussi été impliqué dans le mouvement œcuménique.
Ce podcast de façon arbitraire traite seulement des certains aspects de l’œcuménisme en mettant en avant les enjeux et les difficultés à réaliser les objectifs fixés par les protagonistes. Je veux donc présenter le désir de bien faire, puis aborder les difficultés réciproques. Je me limite aux quelques aspects qui semblent les plus proches du grand public.
I Le désir de bien faire
À l’échelle de l’histoire du christianisme, tout a commencé par la prière de Jésus, qui demande à son Père de protéger ses disciples du mal. Tout en spécifiant une des conséquences de ce mal qu’est le manque d’unité entre ses disciples. Et entre ceux qui vont les devenir, jusqu’à nos jours (Jean 17,21)
Il est bon de rappeler le sens de ces deux mots, unité et œcuménisme, le sens dans lequel ils sont communément admis dans l’Église catholique. Cette remarque sur le sens catholique de ces mots, mérite d’être précisée en comparaison avec les autres églises chrétiennes pour savoir comment ceux-ci comprennent ces mots. On reviendra plus loin. Pour le moment, restons avec le sens catholique.
Unité.
En général, le sens du mot unité ne semble pas poser de problème aux catholiques. On y est d’accord ou pas, mais unité veut dire tout ou rien, unis ou séparés. Le raisonnement du tout ou rien, est fondé sur la théologie de l’Église selon laquelle l’Église est comparée au corps (du Christ) (1 Co 11-12). C’est une de trois images principales de ce qu’est l’Église selon la Bible, les deux autres étant le peuple (de Dieu) et le Temple (de l’Esprit)
L’image du corps appliquée à l’Église suppose une unité ontologique, elle est inscrite dans le code génétique du baptisé. Alors que l’unité du peuple pour se réaliser suppose une volonté personnelle du croyant qui veut, oui ou non, appartenir à ce peuple de façon visible pour assumer et rendre visible cette unité ontologique. Les communautés juives le savent bien, pour réussir à rassembler les membres autour de la Tora, il faut faire des efforts de deux côtés. La loi limitant à deux mille le nombre des pas à faire le jour du shabbat en dehors du village ou de la ville oblige à anticiper pour être disponible à célébrer le Shabbat ; vivre dans la proximité immédiate de la synagogue pour s’y rendre peut aussi simplifier la vie. Alors que pour la plupart des juifs n’étant pas en lien avec la synagogue, vivent là où bon leur semble. La conscience d’appartenir à un peuple à part, un peuple de plus élu, est gardé par-delà l’appartenance à la communauté et la fréquentation de la synagogue.
Deux mécanismes semblent régir l’appartenance, et donc garantir l’unité. L’appartenance de fait est constatée par la conscience d’appartenir, dans le cas des juifs, à un peuple à part dans l’histoire de l’humanité, car marqué par un appel, et c’est sans tenir compte de la fréquentation de la synagogue. Dans les cas de chrétiens l’appartenance de fait est constatée par le baptême. Appartenance reconnue par l’intéressé dans le cas de juif, ou appartenance reconnue par l’Église à cause du baptême reçu, des précisions et des nuances qui en résultent seront à indispensable à prendre en compte.
Ce qui pour les catholiques veut dire qu’être membres assumés du corps du Christ suppose d’appartenir au peuple des croyants. Leur unité au Christ précède, fonde leur appartenance au peuple.
2. Œcuménisme.
Pour les catholiques, et non seulement, le terme œcuménisme paraît plus mystérieux, plus complexe. Déjà par son origine et par son usage. C’est un mot qui est issu du participe grec oikoumene “terre habitée” et désigne la gestion de la maison commune. Ce qui donne en français deux mots qui en dérivent : économie et œcuménisme. Il est bon de ne pas perdre de vue la proximité entre ces deux mots. L’économie désigne la gestion de la maison commune aux dimensions d’un foyer, d’une famille, d’une maisonnée, d’une commune, d’un pays jusqu’à la dimension universelle terrestre et surtout à l’époque moderne, même cosmique.
Cela suppose que chaque membre en soit concerné, on lui demande donc à être partie prenante de cette gestion commune. L’économie du travail comme participation à l’effort commun est englobée dans la vision chrétienne d’une présence participative de chaque chrétien à l’œuvre de la création. Et par conséquent cela suppose d’être présent de façon active dans l’œuvre du salut. D’où le terme d’économie du salut employé en théologie catholique pour comprendre comment le croyant peut être un collaborateur de l’œuvre de Dieu dans son ensemble.
On comprend aisément l’exigence de la participation active par le travail sur le plan économique, que tout le monde mette la main à la pâte, à qui au four, à qui au moulin. Mais que fait dedans la religion et ses propres lois ? Qu’ont en commun économie et religion ? En posant ainsi la question, cela révèle notre fond commun propre à la civilisation occidentale qui sépare ces deux-là. Il n’en était pas ainsi dans l’antiquité dont est issue notre civilisation, ni dans des cultures et civilisations traditionnelles. La fonction utilitaire de la religion a toujours été intégrée dans la pensée politique. C’est seulement le christianisme qui a toujours résisté à se faire réduire à la fonction utilitariste d’une vision politique en cours. Mais c’est tout un autre débat.
Les premiers chrétiens se sont retrouvés dans cet héritage de proximité entre l’économie et la religion par le biais des exigences morales. Le désir de rester unis s’inscrit dans cette réalité complexe sociale que la religion épouse et travaille pour la transformer. Unis entre les membres de la religion pour rendre à être unis avec les autres. Or, de fait souvent c’est l’inverse, les chrétiens semblent plus unis avec ceux du dehors qu’avec ceux du dedans.
L’usage du mot œcuménisme peut s’appliquer aux deux principales réalités. De façon reconnue à l’intérieur de la réalité chrétienne pour désigner l’effort de réunion (réunification), employé par les journalistes pour désigner par extension aussi les relations interreligieuses.
Œcuménisme est une réponse à une situation que l’on déplore, celle de la division et séparation, mais qui, c’est un fait, existe bel et bien dans toutes les religions, comme dans toute l’humanité, jusque dans une famille ou dans un couple. Toute division est née dans un cœur humain, car lui-même déjà divisé. Mais un certain christianisme, surtout celui fracturé par la réforme luthérienne, donc les luthériens avec d’autres réformés et les catholiques, ensemble essaient de remédier à la situation de séparation consommée depuis tant des siècles. Et s’ils le font, c’est dans l’esprit de dialogue, pour chercher à se comprendre, en tant que ceux qui font partie de la même maison et donc de la même économie, celle du salut. Dans l’œcuménisme, c’est l’objectif final qui prime dans la gestion des contingences réelles.
Pour terminer cette partie de la réflexion sur le sens du mot œcuménisme, le mot économie qui en dérive peut revêtir l’un de trois sens :
-économie au sens d’activité humaine transformant la matière et assurant des revenus rentables,
-économie au sens de freiner les dépenses,
-économie au sens d’une action visant à chercher et obtenir le salut.
Ce dernier sens permet de faire le lien entre l’économie du salut et l’unité. Car ce qui est commun à tous les chrétiens c’est la vision du monde fondée sur le principe de salut comme solution aux problèmes générés par la réalité du péché provoquée par les puissances du mal. Doit-on alors envisager l’union de moyens et d’actions, pour parvenir au même résultat ? Même la manière de comprendre le salut comme catégorie théologique varie considérablement.
Certes, pas de salut sans notion de péché, mais le spectre de ce qu’est le péché est très large. Chaque confession chrétienne suit sa “sensibilité” chrétienne, sans oublier que à l’intérieure de chacune les sensibilités personnelles varient suivant l’âge, l’appartenance sociale et environnementale culturel… Bref, tout le monde se retrouve confronté au même dilemme, où est-ce que je trouve plus de réponses aux questions que je me pose, dans la religion ou dans la société ?
Comment suis-je libre dans mes choix imposés de deux côtés pour les assumer et en trouver satisfaction ?
La réflexion sur l’œcuménisme comme moyen de répondre à la désunion entre les chrétiens prend acte des obstacles qui pour certains humainement parlant ne semblent pas surmontables. Ce n’est pas pour demain que l’on pourra envisager une vision commune en tout point. Déjà s’entendre en grandes lignes sur l’essentiel paraît beaucoup. Y travaille une commission mixte catholique protestante, appelée Dombes, du nom de la localité en Suisse ou les premières réunions ont eu lieu dès les années 1930. En 1999 les experts ont réussi à préparer une déclaration commune sur la justification par la foi et ou par les œuvres (ce qui constituait l’os de discorde entre les positions) pour la faire signer par les autorités de l’Église catholique et celles des diverses églises issues de la réforme.
La vision du salut entre les orthodoxes et les catholiques est quasiment la même. La divergence sur le Filioque, c’est à dire sur la manière dont on comprend le lien entre le Père et le Fils fut la raison directe de Grand Schisme au XI siècle. Au-delà de la divergence purement théologique, les moyens pour parvenir au salut chez les catholiques et les orthodoxes sont quasiment identiques. Le rôle des sacrements y a son importance capitale ; ce n’est pas le cas des protestants. Ceux-ci ont protesté contre les abus dans l’Église latine sous l’autorité du pape, les abus jugés intolérables au moment de la construction de la basilique Saint Pierre à Rome au XVI siècle. C’est l’autorité du pape qui était visée, celle-ci au lieu de s’exercer pour faire grandir les ouailles dans leur foi, se cabre, durcit la position et se réfugie dans l’autoritarisme identitaire. Rien de plus facile à décevoir et voir les autres partir. On sauve alors ce que l’on peut. Et on évolue séparément.
Luther n’a jamais pensé à se séparer du pape, la séparation s’est faite sous la poussée des princes qui, faisant partie du Saint Empire ont trouvé une bonne occasion pour échapper un peu à la pression fiscale et payer un impôt de moins. C’est l’économie qui a prévalu sur l’unité de la maison commune. L’économie matérielle qui a involontairement pour les réformateurs a prévalu sur l’économie spirituelle. (L’année sainte proclamée par le pape François comprend aussi les indulgences, comme remise de peine afin de faire comprendre les effets sur l’unité des chrétiens et du genre humain du mal causé par le péché.)
Très difficile pour ne pas dire impossible de revenir en arrière. Le pouvoir s’en empare pêle-mêle de deux économies qui, comme toujours, sont forcées de cohabiter, ce qui ne les empêchent pas de faire parfois des coups bas. Le mouvement du chemin synodal qui prend de l’ampleur chez les catholiques allemands dans ce XXIe siècle divise les catholiques, en dessinant une nouvelle ligne de fracture ; les raisons sont semblables à celles de l’époque de Luther, même si les circonstances sont différentes. Et pour l’effet, il faut attendre un peu. Ce n’est plus pour chasser avant tout la superstition et son corollaire que sont les indulgences pour les protestants, que le chemin synodal prend de l’ampleur en Allemagne.
Le chemin synodal se déroule sous la poussée de la prise de conscience chez les catholiques (allemands) de la nécessité de réformer en profondeur le fonctionnement de l’Église. Et par conséquent, en s’alignant sur la société moderne (le pape François y répond en convoquant le synode sur la synodalité), elle-même façonnée par les acquis de la réforme, les catholiques allemands, le long de ce chemin synodal, réclament la parité hommes femmes dans la direction des églises et par conséquent l’ordination des femmes, suppression du célibat …
Comme on peut constater à partir de cette succincte présentation de la situation de l’Église catholique, les avancées œcuméniques sont liées à de telles contingences. Et loin d’être acquise une avancée tant espérée de part et d’autre, même dans un avenir éloigné. D’où la nécessité de prendre en compte toutes ses difficultés qui accompagnent les efforts de l’unité accomplis dans l’esprit Œcuménique.
II Un désir contrarié
Dans cette seconde partie, regardons comment se situer concrètement face aux difficultés constatées, comment le désir de l’unité est conditionné par la réalité.
Alors que fait-on de la prière de Jésus, en constatant qu’elle n’est pas réalisée ?
Est-elle réalisable un jour ? Et si jamais ? Doit-on prendre la prière de Jésus comme visant une réalité purement divine spirituelle, mais humainement inatteignables. On serait face à un discours programme qui indique la direction, mais ne vise pas sa pleine réalisation. Sans doute il y a quelque chose de tout cela, mais ce constat, sous la poussée du réel, ne dispense pas de fournir des efforts pour tendre vers. Tout apprentissage repose sur cette dynamique.
Ce qui freine considérablement les efforts œcuméniques et donc continue à diviser c’est la question de la participation à la même table eucharistique pour partager le même pain et boire à la même coupe. Si déjà au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe, mais surtout à partir du Concile de Vatican II les avancées catholiques dans ce domaine sont considérables, le mouvement œcuménique se heurte toujours à la question du partage de la table de l’eucharistie. Partager la table de la parole, globalement pas de problème, les célébrations communes sont nombreuses.
Passer à la deuxième table pour les invités chrétiens non catholiques (pas seulement les protestants mais aussi Anglicans et les Orthodoxes) se heurte à la pleine communion. Et fait jeûner les invités qui sans grimacer vont remercier pour l’hospitalité. Mais pourra-t-on rétorquer en observant que de toutes les façons leur table eucharistique est démesurément plus petite et surtout moins garnie. Le reproche à mi mot formulé à leur égard de se contenter d’un partage du pain plus ou moins eucharistique (aux yeux des catholiques) autorise cette mise à l’écart.
Certes, dans l’Église catholique des efforts ont été faits pour élargir et enrichir la table de la parole en mettant à disposition des fidèles rassemblés à la messe, plusieurs textes bibliques à méditer. Et dans le remaniement de la messe, il n’y avait nulle part l’idée de demander aux protestants de faire autant de leur côté par rapport à la table eucharistique. Sans doute bonne était l’idée des réformateurs catholiques en interne visant à enrichir la table de la Parole en augmentant le nombre des textes et en diversifiant la table de la Parole, en comparaison avec ce qui était pratiqué avant la réforme liturgique.
Avec plus d’un demi-siècle de pratique, on se rend compte que matériellement on n’a pas le temps d’assimiler le contenu si riche et parfois difficile d’accès pour les contemporains que nous sommes. D’autant plus que les normes qui régissent l’art de prédication, en usage actuellement, pour tenir compte de la capacité de l‘auditoire, ne laissent guère la possibilité d’aborder l’ensemble ou alors de façon très succincte, tout en se concentrant sur un seul aspect. Ce qui n’est pas mal du tout, car il vaut mieux approfondir une question que les lectures et l’Évangile en particulier pose à l’auditoire. En revanche, ce qui laisse songeur c’est le fait que la quasi-totalité du contenu de lectures échappe à l’attention des fidèles. Des ajustements sont à envisager, alors que prédicateurs protestants se concentrent sur un aspect du message biblique choisi et soigneusement préparé pour le présenter dans un long développement qui parle.
Avec les risques inverses. Les catholiques tiennent davantage à la vision globale, dogmatique pour l’appliquer à la vie quotidienne. Les protestants s’attachent à un point particulier, au risque, selon les catholiques, d’une surinterprétation du passage biblique. Mais il faut se méfier d’une simplification à outrance d’une telle distinction, car ce qui est opératoire en grandes lignes dans les généralités, souvent est bâti en brèche par les détails.
Revenons à la table eucharistique.
Dans la vision catholique, le corps du Christ est déchiré dans les séparations entre les chrétiens. Pour les protestants, l’appartenance à la même Église (romaine et catholique) n’est pas envisageable selon les critères édictés par les catholiques: la même profession de foi, les mêmes moyens de salut que sont les sacrements, la même autorité, celle du pape. La vision protestante prend acte de la séparation définitive (pas de soumission à la même autorité ecclésiale, chacun chez soi) et vise le rapprochement spirituel sur le terrain pas seulement de la parole de Dieu, ce qui semble acquis du côté catholique, mais le terrain de l’eucharistie pour manger ensemble, sans être certain qu’en mangeant le même pain et buvant à la même coupe on mange le même corps et boit le même sang.
Les intérêts pour l’œcuménisme ne sont pas les mêmes et le maintien du désir à être unis n’est pas réalisé avec la même force.
Les catholiques sont soupçonnés par les protestants de vouloir les intégrer dans le giron de l’Église catholique, les protestants maintiennent la pression sur l’accès à la communion comme signe de l’unité, ce qui provoque la résistance catholique. À force de se confronter et de jauger, finalement tout le monde reste essentiellement sur ces positions, les blessures réciproques et les préjugés, entretenus parfois de façon bien assumée ou à mi-mot, n’aident pas à se faire des amis au niveau institutionnel et donc inter confessionnel.
Un autre point de discorde a surgi lorsque les églises non catholiques ont revendiqué le même statut que l’Église catholique. Écrire le mot Église en majuscule pour désigner une des églises protestantes n’est pas neutre. Le débat bien présent déjà lors du second concile de Vatican n’est toujours pas clos. Peut-on appeler des églises sœurs celles qui se sont séparées de l’Église catholique qui est pour elle la grande sœur ou église mère comme l’intéressée prétend ?
Le corps du Christ divisé de la sorte, peut-il assumer son unité malgré de telles discordes, au point de pouvoir prendre le même repas, dont nous avons traité plus haut ?
Chaque année, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens est accompagnée par un thème.
Cette année c’est autour de la foi commune des chrétiens telle qu’elle est exprimée dans le credo formulé lors du concile de Nicée il y a 1700 ans, en 325. Le thème a été préparé par la communauté monastique de Bose en Italie, bien connu pour ses engagements œcuméniques.