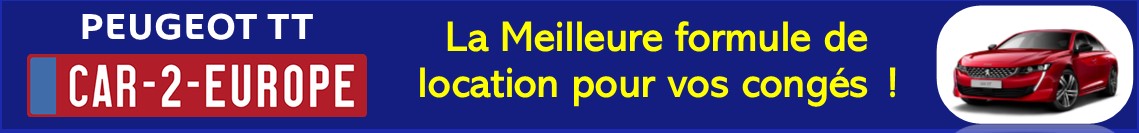La grève de la faim comme effort de carême.
Tout va s’éclaircir après la lecture de ce communiqué.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
“Les femmes catholiques en grève pendant le Carême pour dénoncer les inégalités.
Cette année, un mouvement inédit voit le jour : les femmes catholiques engagées dans leur paroisse font grève.
Leur objectif ?
Dénoncer les inégalités femmes-hommes persistantes au sein de l’Église catholique.
Ce mouvement intitulé “Catholic Women Strike” a été initié par l’association américaine Women’s Ordination Conference et est suivi par des associations du monde entier, dont en France le Comité de la Jupe, association féministe catholique.
Le carême, du 5 mars au 12 avril 2025, est pour les catholiques un temps de jeûne, de prière et d’aumône, afin d’entrer plus profondément en relation avec Dieu (1). Cette année, les femmes jeûnent du sexisme et du patriarcat, afin de connaître plus profondément le Dieu qui a créé tous les êtres humains à son image.
Le travail invisible des femmes dans l’Église en France, les paroisses fonctionnent en grande partie grâce au travail bénévole des femmes. Elles assurent l’éducation religieuse (catéchèse), animent et préparent les célébrations, prennent en charge l’entretien des églises et participent à la préparation des funérailles. Sans leur engagement, de nombreuses paroisses peineraient à survivre.
Malgré ce rôle central, les femmes sont écartées des prises de décision à tous les niveaux de l’institution catholique, seul le curé est décisionnaire en sa paroisse et l’évêque en son diocèse : le pouvoir est toujours associé à la fonction de prêtre et donc à la masculinité. Cette discrimination affaiblit l’Église et menace son unité. En 2022, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) a d’ailleurs recommandé de renforcer la présence des femmes dans les sphères décisionnelles, à la suite de son rapport sur les violences sexuelles dans l’Église.
Un appel à la grève pour la reconnaissance des femmes dans l’Église. Fatiguées d’être les « grandes oubliées » de l’institution, les femmes catholiques lancent un appel à la grève de leur service bénévole en paroisse (souligné par RK). En se retirant temporairement, elles espèrent que leur contribution essentielle sera enfin reconnue. Leur objectif est de souligner l’importance de leur rôle et de provoquer un changement dans les pratiques de l’Église catholique.
Depuis des décennies, les mêmes excuses éculées continuent de tenir les femmes à l’écart des ministères ordonnés (« Pas mûr », « Une plus grande maturation est nécessaire » …) alors que les commissions et les groupes d’études au Vatican se succèdent sans résultats tangibles.
Cette grève symbolique s’adresse aux catholiques qui souhaitent manifester leur déception, leur colère et leur lassitude devant cette lenteur. C’est un appel à l’action : les femmes catholiques n’attendent plus que les hommes ordonnés décident du moment propice pour réformer l’Église.
Contact presse :
Adeline Fermanian, co-présidente du Comité de la Jupe, adeline@comitedelajupe.org (06 83 38 74 59)
(1) Dans la tradition catholique, le Carême s’étend sur les 40 jours précédant Pâques. Pendant cette période, les fidèles sont appelés à modifier leurs habitudes pour accorder leur vie au message de l’Evangile.”
Que faire?
J’ai beaucoup hésité avant de savoir si je choisissais ce communiqué comme sujet de podcast ou pas. Les arguments pour ne pas le faire sont pragmatiques et de fond. Serai-je en mesure de bien préparer le sujet dans un délai raisonnable pour le présenter un dimanche de carême tout en étant éclairé dans mes propos? Quel effet cela va-t-il avoir sur les auditeurs/lecteurs? Quel sera l’impact positif et quel sera l’impact négatif? Et que veut dire impact positif et négatif, et pour qui?
L’objectif de ces podcasts n’a jamais été de donner des recettes, encore moins d’infléchir la volonté de qui que ce soit, à partir des développements proposés. Juste nourrir une réflexion personnelle en conscience, aussi bien celle de l’auteur que celle des bénéficiaires éventuels, plus ou moins chrétiennement éclairée.
Pour ces raisons, j’ai décidé de faire ce podcast. Ce n’est pas une plateforme publicitaire, ni protagoniste, ni délétère. C’est une plateforme réfractrice au sens de ce qui a la propriété de réfracter la lumière en faisceaux qui peuvent aider à voir en détail les enjeux d’une telle initiative.
Ici la grève de la faim, même entamée de manière symbolique en s’abstenant du bénévolat, comme jeûne d’engagement, est pensée pour faire pression sur ceux à qui cette grève est destinée. Dans le contexte social actuel, pour cette cause qui plus est, la pression s’exerce d’autant plus efficacement que le sujet est mis sous les projecteurs des médias.
Détournement de carême
Le détournement du carême 2025 au profit d’une cause aussi louable soit-elle, est un acte qui interroge.
La grève de la faim est l’ultime étape des négociations, lorsqu’elles se trouvent dans une impasse, sans aucune issue possible. La situation n’est soluble ni par le dialogue, ni par les menaces. Souvent la confrontation ainsi engagée se termine sous la pression dissuasive de la force et par l’abandon des revendicateurs qui rentrent tête basse et bredouilles. Souvent aussi ce sont les destinataires des revendications qui rentrent tête basse en cédant aux pressions de la rue.
Jouer la montre est une technique parmi les plus efficaces. Le temps éprouve les nerfs et les arguments flétrissent devant le mur infranchissable que la volonté de tenir coûte que coûte dresse entre les revendicateurs et l’autorité ainsi interpellée, voire remise en cause. Même chez les plus fins négociateurs, l’emportement peut prendre le relais, la lassitude gagne et les rancœurs s’installent. Dès l’instant où le projet des négociations est conçu et su, tous ces sentiments sont déjà présents chez les protagonistes, en germe, leur développement dépendant des circonstances.
Le mécanisme de la friction ainsi engendrée est bien connu. Il peut se poursuivre en alimentant des ressentis supplémentaires qui se transforment rapidement en ressentiments. Ou alors l’affaire se solde par l’abandon des revendications qui scelle les rancœurs dans une rage étouffée ou qui explose. Les déceptions très profondes sont scellées à très long terme dans un abattement irrémédiable. L’isolement et la non communication en résultent.
On pense souvent que laisser agir le temps verra la mort du projet et la mort des protagonistes. Tout processus de mise en place des nouveautés impopulaires (pour des raisons économiques, stratégiques, culturelles, politiques et religieuses en l’occurrence, etc) est confronté à la force de la résistance dans la durée.
La grève de la faim symbolique des femmes catholiques est organisée en vue d’obtenir l’égalité des droits avec les hommes dans un système inégalitaire, marqué par le sexisme et le patriarcat, dénoncé comme tel dans l’Église. Mais durant le carême, elle a plusieurs résonances.
La pratique du carême, cultivée dans plusieurs églises chrétiennes et dans l’Eglise catholique ici, concerne trois manières d’exercer la volonté, pour être plus apte à écouter la Parole de Dieu et la réaliser. Le jeûne, évidemment, mais aussi la prière et l’aumône. Dans le cas de l’initiative en question, ne sachant pas si les trois sont pratiqués conjointement, on ne peut rien dire de l’impact de la prière sur ces décisions. Or, le fondement des actions de carême est dans cette priorité-là.
Dieu nous éprouve dans la durée, même si nous nous sentons éprouvés de façon plus sensible par des épreuves de courte durée. Le reste plonge dans les limbes de l’histoire longue où les conséquences, tout en épuisant la résilience, sont reléguées dans la sphère privée, où chacun se débrouille comme il peut. C’est ce danger du temps long que redoutent les initiateurs de la grève : il faut agir en empêchant la sclérose de la revendication à laquelle tout le monde va s’habituer. Pas mûr, pas bien préparé… Le rapport au temps est remplacé par l’insistance sur la gravité du sujet. Le temps travaille contre ceux qui désirent que ça bouge. Alors que ceux qui prennent le temps risque de s’engourdir sous l’emprise de somnolence. Pour cette raison déjà, il est bon que des piqûres de rappel réveillent sur l’importance à accorder au traitement de ce genre de sujet. Car au final sont visés l’homme nouveau et la femme nouvelle.
Dans ce contexte, la prière, fondement et réceptacle du jeûne et de la charité, devient le liquide amniotique de la gestation d’une nouvelle création, d’un être recréé. Cette gestation spirituelle aboutit à l’accouchement d’une vie nouvelle pour les baptisés à Pâques et au renouvellement de la vie chrétienne pour tous les déjà baptisés.
Transposant cette approche spirituelle à la grève des services rendus en Eglise, la charité est bien visible par la négative. Il s’agit de montrer l’importance des services rendus, ce que l’on voit d’autant mieux lorsque l’on en est privé. Par négation, et donc par contraste, on obtient une image plus nette et plus forte de ce qu’est cette charité. Les grèves des transports en sont la meilleure illustration. Évidemment, le service n’a pas la même résonance dans le monde des bénévoles que dans le monde des salariés. Mais les effets sociaux et communautaires sont de même nature ; tout acte individuel ou collectif a une résonance universelle.
Le communiqué ne parle pas de la corrélation, pourtant non négociable, entre le jeûne, le partage et la prière. Le jeûne symbolique des femmes a pour objectif d’infléchir la décision des responsables d’Église qui sont, par définition, des hommes exerçant leur pouvoir dans des structures patriarcales.
Égalité à chercher
La situation des mouvements féministes à l’origine de cette grève de la faim symbolique est comparable à la situation du gouvernement d’un pays qui lance des réformes impopulaires, surtout quand elles sont d’ordre économique. C’est particulièrement prégnant quand la décision politique impacte la dure réalité sociale en exigeant de réels efforts de la part de tous, le gouvernement y compris.
Il n’y est pas question d’une éviction du problème économique du pays par l’élucidation idéologique populiste envisageant de réduire les impôts et augmenter les salaires. Dans la perspective idéologique, marquée par une propagande mensongère, le bonheur qui était dans le pré de quelques-uns sera désormais accessible à tous. Mais c’est au prix de beaucoup d’efforts et surtout de l’exclusion de certains, désignés comme coupables. Pour montrer que ça marche, on va se mettre au travail. En résultent les conflits armés avec ceux qui n’ont pas compris le mode opératoire à l’intérieur et avec ceux de l’extérieur qui ne veulent pas comprendre le bienfait que cela produit.
Vouloir affronter les structures patriarcales, c’est remettre en cause la construction mentale qui précède et qui en résulte. Remettre en cause leur bien fondé peut faire du bien. C’est comme s’interroger sur le bien fondé de la foi et de ses auxiliaires que sont la charité et l’espérance. Si on l’enlève, que restera-t-il du message véhiculé ? Dieu sera-t-il encore Dieu le Père ? Tout commence là, le reste se détricote de lui-même. Ceux qui défendent une telle dynamique funeste pour la religion se défendent comme ils peuvent.
Le pape François n’a pas peur d’aller au détricotage des structures de l’Eglise, depuis le début de son pontificat. L’accusation dont il est chargé pèse d’autant plus lourd qu’elle suit cette logique de détricotage jusqu’au bout. Mais chaque fois qu’il est attiré sur ce terrain, il s’en défend. La théorie du genre dans ces conséquences morales en est un exemple.
On se souvient du catalogue des péchés capitaux de la curie romaine qu’il égrène lors de son discours, à l’occasion des vœux, peu après son élection en 2013. Parmi les 15 maux, il dénonçait notamment l’endurcissement mental ou spirituel, l’Alzheimer spirituel et la déification des chefs. Avec cela, il y a déjà matière à faire une bonne purge. J’ai envie de faire un podcast sur le lien entre l’endurcissement mental et spirituel ce qui, à mon avis conduit à l’Alzheimer spirituel.
Mais quand il dénonce ces travers, il ne vise jamais de façon frontale et radicale le bien fondé théologique du modèle patriarcal, sur lequel reposent la théologie chrétienne et les structures de l’Eglise. Avec toute son ouverture, il n’essaie pas d’être une femme, pour comprendre ce que les femmes peuvent ressentir à ce sujet. Avec les forces qui lui restent, il prend des initiatives inédites, en nommant récemment une femme à la tête de la gouvernance du Vatican.
Pourtant, en promulguant cette nomination, il reproduit le schéma traditionnel. Assigner une femme (une religieuse) à la gouvernance du Vatican parait procéder du bon sens. Même si des majordomes sont réputés, leur formation au sein de l’Église Catholique ne semble pas suffisante. À moins que le vivier potentiel pour choisir parmi des prêtres et les former ne soit pas suffisant non plus, ce qui oblige de facto à aller chercher ailleurs.
La vérification du bien fondé de la structure patriarcale s’impose. Mais les opposants, qui se trouvent parmi les prêtres et les évêques, non seulement, fleurent une atteinte à leur identité ministérielle et par principe ne veulent céder sous aucun prétexte. A leur avantage, la théologie classique a déjà réglé le problème de la place des femmes dans l’Eglise et cela a toujours été d’une clarté et simplicité angélique. On peut reconnaître du bout des lèvres des abus d’autorité liés à l’exercice de responsabilité dans le cadre des structures “patriarcales et sexistes”. Cependant, les mea culpa d’un “patriarche” repenti, en son nom ou celui de ses subordonnés, ne suffisent plus.
La Bible et la foi qui en émane sont formelles. Mais comment? D’aucuns se mettent à songer, sans se l’avouer vraiment, à une Eglise sans femmes. Ce serait tellement plus simple pour les promoteurs de la stabilité. Derrière ce ton légèrement sarcastique, il y a le désir de signaler nos a priori, et ils se trouvent des deux côtés. Céder aux revendications d’accès des femmes au sacerdoce… sous prétexte de la diminution drastique des vocations masculines, c’est réagir avec l’air de temps. Même s’il y a des situations qui sont de bonnes piqûres de rappel pour la théologie chrétienne et catholique en l’occurrence, il faut encore que ceci soit accepté librement et sans contrainte, au risque d’invalider le résultat, comme pour un mariage forcé. Donc : au secours la Bible!
La Bible pourvoyeuse de sens
Ainsi pour y voir plus clair, il faut ausculter la figure d’Abraham, Genèse 12-25.
Il faut le faire à la lumière des critiques visant les déviances, ce en quoi le pape consent en écoutant les critiques des mouvements féministes ou autres. Il faut aussi l’ausculter du point de vue de la théorie du genre, qui dissocie la distinction biologique entre les sexes et l’appréciation qu’on leur assigne. Je décide moi-même de savoir qui je suis. Désormais, tu t’appelleras Abraham. Recevoir un nom veut dire accepter une identité objective, non modifiable. Est-ce le témoignage d’un passé révolu, ou une constante qui traverse les générations?
Le même mécanisme opère dans l’appréciation de l’identité dite nationale où les critères objectifs sont enrichis, voire subordonnés, aux critères subjectifs. Dans la mentalité actuelle, la décision personnelle, (je suis un tel ou une telle, homme ou femme, entre les deux, etc), proclamée haut et fort, a une valeur objective qui lie la société dans son ensemble. Et là, on se rend vite compte que dans la perspective biblique, bien que totalement immergée dans la culture d’alors sexiste et machiste, la figure d’Abraham n’est pas avant tout celle d’un mâle dominant, mais celle d’un croyant soumis à la volonté de Dieu. C’est l’expérience qu’il fait tout au long de son éprouvante existence.
Sa masculinité n’est que secondaire, alors que prime la qualification de Croyant, qui qui n’a pas de sexe, comme le premier humain dans le récit de Genèse 2,7 avant que la côte d’Adam serve à en faire sa compagne. C’est pour la théorie. En pratique Abraham, estampillé comme père des croyants, ne s’est pas transformé d’un patriarche sexiste, en père/mère. Il n’est pas non plus devenu en un clin d’œil le prototype parfait du fils de Dieu.
La Bible n’oublie pas de souligner l’imperfection humaine des élus de Dieu. Elle le fait sans doute faute de mieux, car personne parmi les humains, hormis la Vierge Marie, ne peut correspondre aux critères de perfection en cochant toutes les cases. Ce que les mouvements féministes ont bien compris, la lutte pour l’égalité des femmes se déroule nécessairement dans ces conditions marquées par l’imperfection structurelle de tout en tout.
Revenons à la Genèse 12 : comment Abraham devient père des croyants, comment cela le transforme. Une famine conduit Abraham en Egypte, où il va cacher la vraie nature de Sara à Pharaon par crainte de mourir. Ou encore dans Genèse 20, qui peut se comprendre comme la relecture et l’interprétation de Genèse 12, où Abraham va faire la même chose face au roi Abimélek. Le juste dans l’histoire, ce n’est pas Abraham, c’est le roi païen qui, mis au courant en songe du plan de Dieu, lui obéit et reconnaît la Seigneurie divine, telle que la Genèse la met en avant, le roi élu de Dieu.
Certes Abimélek est opposé à la figure de Pharaon qui n’a rien de bon aux yeux de la Bible, mais dans un cas comme dans l’autre, c’est le patriarche qui est défaillant pour Dieu qui lui apprend comment être à la hauteur de sa mission.
Abraham, et ses successeurs encore moins, n’est pas la parfaite image du croyant. Tous, par contre, sont porteurs d’un «idéal » de sainteté, ce qui replace la question sur un autre terrain, celui de la relation dynamique. Mais la valeur supposée de cette relation dynamique est facilement remise en cause. On le voit dans le regard posé sur ces chrétiens qui vont à la messe et pourtant… Or, le chemin pour se reconnaître chretien c’est de se reconnaître pécheur parmi les pécheurs. Les bien portants qui jugent n’ont rien à faire ici.
Le chemin du croyant sur la route qui mène vers plus de sainteté est long, sinueux, menant par les ravins et à flanc de collines, ennuyeux comme l’autoroute qui traverse le désert. Mais la qualité commune à tous est la repentance. Et surtout l’espérance. C’est ce qu’attendent aussi les initiateurs des Catholic Women strike et les mouvements qui le soutiennent.
Le temps ordinaire est passé
Ils dénoncent avant tout les déviances qui apparaissent dans le fonctionnement. L’attention déjà séculaire portée sur les conditions de vie des femmes dans la société civile pénètre les structures et le fonctionnement de l’Église.
Le collectif des Women’s Ordination Conference avait déjà planifié cette action en 2020, mais à cause de la pandémie, le projet avait dû être ajourné. En 2021, au côté d’autres activistes, les membres ont participé au Vatican à la première phase du Catholic Women Strike est une initiative qui émane de la Conférence de l’Ordination des femmes. C’est une organisation américaine qui, au travers de Catholic Women Strike, cherche à lever les obstacles qui empêchent l’accès des femmes et des personnes de tout genre au ministère, y compris ordonné, et à la gouvernance. Cette initiative s’inspire de la grève des femmes islandaises de 1975 qui, en signe de protestation contre les inégalités dont elles étaient objectivement victimes, ont fait une journée de grève, refusant durant 24 heures de travailler comme salariées et ou comme femmes au foyer.
Le mouvement du Carême 2025 incite les femmes à marquer leur revendication d’égalité par l’absence d’action dans l’Église. Le titre “le temps ordinaire est déjà passé”, porte en lui une manière très élégante de signifier comment passer du temps ordinaire dans la vie de l’Eglise vers le temps du combat spirituel, et plus si affinité. Le changement de couleur liturgique du vert au violet aboutit au blanc, couleur de la résurrection, mais passe nécessairement par le rouge de la Passion. Or, les initiateurs de cette transformation ont-ils pour visée finale la réalisation de la volonté de Dieu. Vaste question, comment le savoir ? Toujours est-il que, au travers de telles actions, Dieu attirerait l’attention de ses ouailles sur des problèmes toujours non résolus dans l’Eglise.
L’annonce sur le site se termine par une belle citation du cardinal Jean-Claude Hollerich “If women do not feel comfortable in the Church, we have failed”. Si effectivement la femme ne se sent pas bien dans l’Eglise, l’échec est évident.
Cette citation qui s’applique directement aux femmes pour signaler leur mal-être dans les structures de l’Église, peut être entendue en toute autre situation de malaise, y compris dans l’église bâtiment. Ainsi, être invité à passer du fond de l’église pour prendre place devant, au premier rang resté vide, durant la messe n’est pas évident. L’invitation peut provoquer une gêne pour celui qui, exposé et marqué de cette expérience négative, préfèrera se taire, quand il sera interpellé sur un autre sujet.
Si on n’est pas à l’aise dans une église, on n’est pas à l’aise non plus dans les questions qui la touchent. Ou alors on est maladroit. Mais c’est toujours mieux que de ne rien dire, car derrière toute maladresse (y compris celle de la grève de la faim) se cache une vérité profonde que l’on n’a pas toujours envie de regarder en face.
Le pape François, en invitant tous les acteurs de l’Eglise au débat dans le cadre de la synodalité, et plus largement en ouvrant la discussion sur des sujets hautement sensibles, a pris le risque de donner la priorité aux ressentis. Et pourtant la température ressentie est bien souvent différente de celle affichée objectivement sur le thermomètre.
Le malaise s’étire de part et d’autre. Passer outre, oublier, ruminer, etc n’est jamais la bonne solution, on est coincé chacun dans son coin. “Jusqu’à quand Seigneur, jusqu’à quand?”
Photo : © Matias Arraez/ France 3