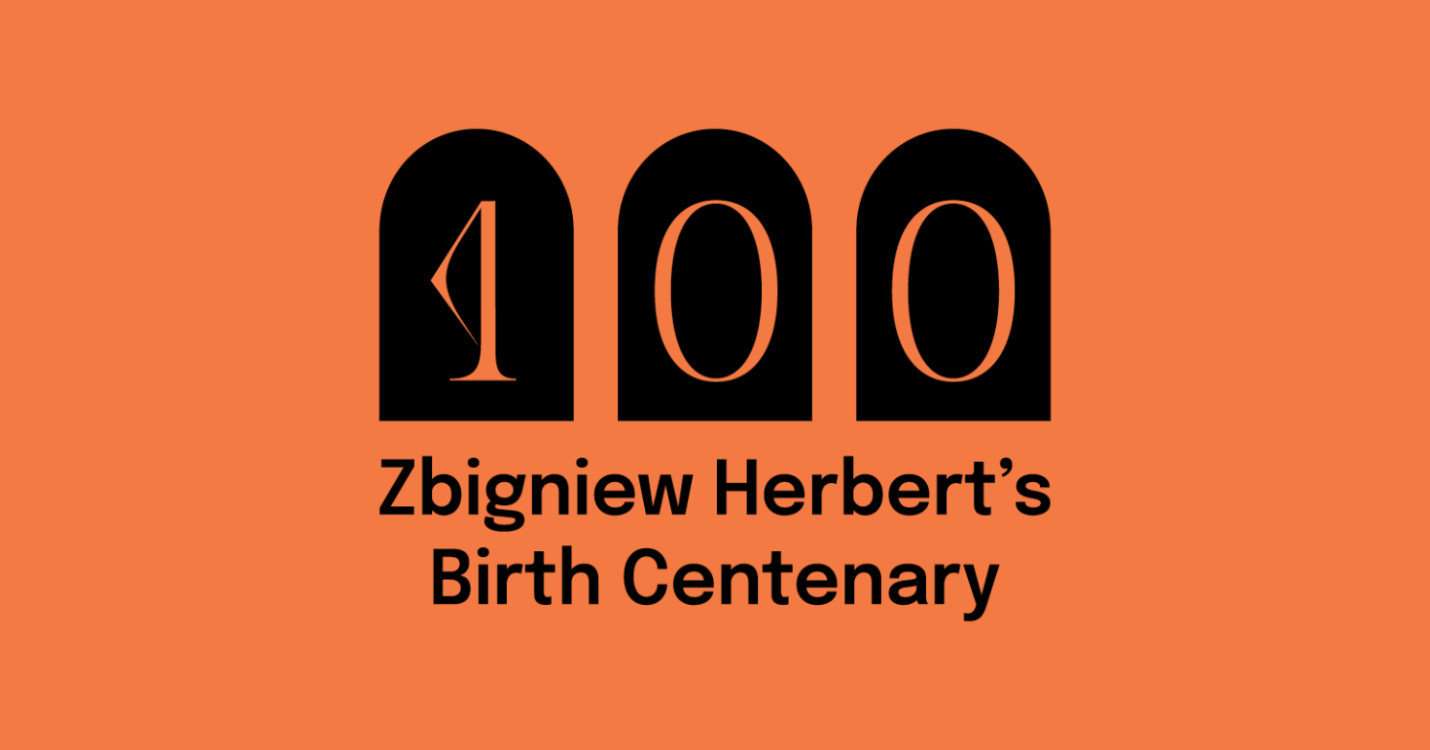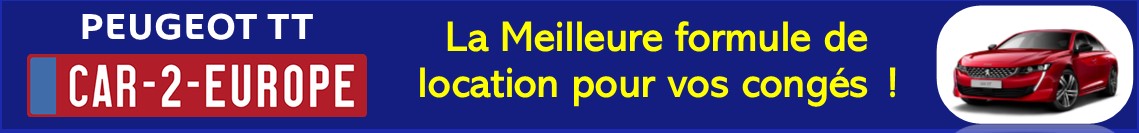Une journée qui fait rêver
J’ai eu vent de cette journée par un communiqué de presse en polonais qui la mettait en lumière à l’occasion du centenaire de naissance d’un poète polonais Zbigniew Herbert (1924-1998). L’occasion fut trop belle pour ne pas la rater.
Depuis que l’esprit humain est capable de communiquer à l’aide d’images, de sons et de mots, l’indicible devient dicible. Tel est l’enjeu de la poésie. Être au service d’une sensibilité qui pose un regard particulier sur la réalité vécue et ressentie. C’est ainsi que se mettent ensemble au service de l’auteur qui est aussi le commanditaire, les chiffres (sciences dites naturelles) et les lettres (sciences dites humaines), dont sont composés les codes de nos vies qui nous permettent d’accéder à notre auto-conscience.
Une initiative louable pour la défense des minorités
La journée internationale de la poésie a été initiée en 1999 par l’Unesco dont le siège principal se trouve à Paris. On connaît ce sigle, sans forcément savoir ce qu’il recouvre, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. En promouvant cette action, les initiateurs et les organisateurs se donnent pour objectif de soutenir la diversité linguistique à travers l’expression poétique. Ils veulent ainsi donner la voix aux langues en danger.
La poésie est alors considérée comme un écrin, un réceptacle de la particularité culturelle qui s’exprime au travers chaque langue, jusqu’à celles les moins perlées sur les lèvres car seulement parlées par quelques petits groupes ethniques qui survivent encore dans leur particularité linguistique y compris.
Vouloir donner de la voix aux minorités linguistiques pour les défendre est un contre pouvoir qui s’ajoute sur la liste d’autres causes défendues par les organismes internationales et locales. La poésie est donc promue de façon fonctionnelle, utilitariste même. C’est aux acteurs de savoir comment en tirer profit pour l’esprit humain ainsi défendu dans sa particularité. Sans pour autant se laisser contaminer par des opportunistes qui risquent d’infecter les esprits des poètes et de leurs bénéficiaires. Nous allons voir cela sur quelques exemples qui vont suivre un peu plus loin.
La journée de la poésie est connue comme un événement promotionnel. Ceci ne déroge pas à la règle de toutes les commémorations qui visent à promouvoir les attitudes comme : souvenons-nous, plus jamais, nous sommes plus forts, non pasarán et d’autres aux armes citoyens etc! Ici l’objectif de la journée passe par la promotion de la lecture, de l’écriture, des publications et de l’enseignement de la poésie dans le monde. En suivant les termes exacts de la déclaration de l’Unesco, il s’agit de « donner un nouvel élan pour reconnaître la place de la poésie sur le plan national, régional et international. »
On ne peut qu’être d’accord avec une telle initiative louable, non seulement sur le plan culturel, mais aussi et surtout sur le plan de la vie concrète des gens. Car si la poésie ne remplit plus sa fonction d’émerveiller et de conduire chacun (bénéficiaire tout comme l’auteur qui en bénéficie déjà pour lui-même) dans les profondeurs de son être, cela conduira à la désertification de l’environnement humain réduite à une sèche et froide existence consommable et jetable par les semblables.
La défense de la paix par la poésie.
Parmi les initiatives prises par les organisateurs se trouvent l’action intitulée « Offre un poème ». Cette proposition vise à promouvoir l’éveille à la poésie des élèves des écoles qui font partie du réseau international des écoles associé de l’UNESCO.
« Le Réseau des écoles associées de l’UNESCO (réseau) rassemble près de 10.000 écoles dans 181 pays autour d’un objectif commun, élever les défenses de la paix dans l’esprit des enfants et des jeunes. »
Je ne sais pas si les lycées français à l’étranger en font partie, mais je peux supposer que oui. Le thème de la paix étant de plus en plus d’actualité, la poésie a son mot à dire. Si élever la capacité de défense de la paix dans l’esprit des enfants et des jeunes passe par la poésie, cet objectif ne se réalise pas uniquement par la poésie.
D’auxiliaire par rapport à une éducation directement visant la paix, la poésie comme toute expression humaine peut être utilisée pour des fins de défense de la paix en termes de la défense d’une paix. Une paix pour les uns, une autre paix pour les autres. Jusqu’à la confrontation de différentes façons d’envisager la paix. Cette confrontation est le lot commun de la coexistence des différentes minorités linguistiques et plus largement culturelles. Au point de devenir parfois une lutte pour la paix avec les moyens de dissuasion, et si besoin l’usage de la force pour l’imposer. Les découvertes scientifiques et leurs applications, tout comme leurs corollaires artistiques peuvent être déviés de leur trajectoire visant à servir la paix qui parfois passe par la guerre.
Si je pousse ma réflexion jusque là, c’est pour montrer l’étendue du terrain d’action humaine en faveur de la paix, tout en cherchant à savoir de quelle paix parle-t-on et à quel prix. Sur cette étendue la poésie pose son regard, parfois un regard libre de s’exprimer comme l’auteur l’entend, parfois sous forme d’une commande au service d’un bien commun. Or, la poésie, tout en s’exprimant sur un terrain restreint, ne peut être qu’au service du bien commun en général et non pas au service d’une cause particulière qui serait en contradiction flagrante avec ce bien commun universel. Si le respect d’un tel bien commun conditionne et précède la commande, la poésie permet de le mettre en valeur.
La poésie, libre et esclave
Une rapide consultation sur Internet fait apparaître deux types de situations évoquées pour parler de la poésie au service de la paix. Sont mentionnées des productions poétiques en faveur de la paix en Afrique et plus récemment en Palestine. Le second concerne un regard posé sur l’histoire de la poésie en Allemagne, plus exactement dans la zone linguistique germanophone du XVIIIe siècle.
Chaque fois c’est en lien direct avec la difficulté de vivre en paix, si non pourquoi en parler. C’est comme avec l’air que l’on respire, tant qu’il ne trouble pas le fonctionnement normal du corps, hormis une pure curiosité scientifique, on n’a pas besoin de s’intéresser outre mesure à sa composition et à sa qualité. C’est le manque qui crée le besoin.
Pour comprendre l’usage de la poésie en faveur de la paix, regardons de plus près comment celle-ci a fait ses preuves dans le passé. C’est dans l’article de Françoise Knopper, “La culture poétique de la paix dans la littérature allemande” (1748-1802), p. 107-124, que je puise toutes les citations.
L’abstract dit l’essentiel.
“Les odes à la paix sont un genre qui, dans la poésie allemande, a acquis des lettres de noblesse dans le cadre de la guerre de Trente Ans et des traités de paix de Westphalie [1648]. Ce genre continuera à être cultivé au long du XVIIIe siècle et sera omniprésent en 1763. Les modifications dont il est alors l’objet sont multiples et semblent significatives d’une autre manière d’écrire l’histoire : tentative de reprendre et d’individualiser la représentation d’une allégorie ; participation des gens de lettres et, par leur intermédiaire, de l’opinion publique à la gestion des affaires politiques ; élargissement de l’horizon territorial.
Cet exposé proposera l’analyse d’une quinzaine d’odes à la paix, le plus souvent publiées dans des revues allemandes, qui furent écrites à l’occasion des commémorations des traités de paix de Westphalie, puis de la signature du traité de 1763 ou encore celle de la paix avec la France révolutionnaire en 1797. »
Exemples
1. Une ode3 rédigée par Justus Möser (1720-1794), jeune juriste qui se rendit plus tard célèbre en tant qu’homme de lettres et historien. Le poème intitulé 1748 fut composé pour célébrer le centenaire de la paix de Westphalie
La rhétorique de Möser en apporte une preuve du service de la poésie à la cause de la politique :
Was rührt mich vor ein plötzlich Schrecken?
Was will der Stücke Knall entdecken,
Wovon die Erde furchtbar dröhnt?
Ist Mars vor unsern Thoren wieder?
Wie? Nein; ich höre Jubellieder;
Mars und Irene sind versöhnt.
Sie braucht den Donner seiner Stücke,
Um ihrer Freundschaft seligs Glücke,
Das Glücke unbesorgt zu ruhn,
Den fernsten Völkern kund zu thun.
Pourquoi cette peur soudaine ?
Que signifient ces coups de canon
Qui font effroyablement trembler le sol ?
Mars est-il revenu aux portes de la ville ?
Mais quoi ? Ce sont des chants d’allégresse que j’entends ;
Mars et Irene sont réconciliés.
C’est elle qui a besoin du grondement de ses canons
Pour annoncer aux peuples les plus éloignés
Qu’ils ont le bonheur de reposer en toute quiétude »
« Avec son intitulé explicite quant à la date et au lieu, avec la solennité de cette manifestation commémorative, avec son rythme lent et ses rimes régulières, cette ode est conforme aux consignes que Gottsched avait données, dès 1730, celles d’imiter la poésie d’Horace. »
Möser en profita pour oser contester le bellicisme des princes. Le poème fut lue le 25 octobre 1748, jour pour jour cent ans après la signature du traité mettant un terme à la guerre de Trente Ans.
2. Joachim Christian Blum (1739-1790), est un érudit local qui dans son idylle magnifie son roi pour avoir restitué « à la Germanie » son amie, « la paix » :
Wir wollen, wo wir deinem Blick
Im Thal, auf Höhn begegnen,
Bringst du Germaniens Glück,
Den Frieden, seinen Freund zurück;
Mit Thränen jeden deiner Pfade segnen!
Nous voulons, partout où nous croisons
Ton regard, par monts et par vaux,
Quand à la Germanie tu rapportes le bonheur,
La paix, son amie,
Béni de nos larmes chacun de tes chemins »
3. plus tard, en 1840, lors de la crise du Rhin – les exemples en seraient nombreux, tels que ce quatrain17 :
Ich kann das Friedensfest mit Tanz
Nicht feyern, kann nicht jubiliren
So lange wir den Rhein halbiren
Ist keine Freude ganz
Je ne peux pas fêter la paix par des danses,
Je ne peux pas exulter,
Ma joie ne sera jamais à son comble
Aussi longtemps que nous devrons partager le Rhin.
31
4. encore ce jeu de mots avec son surnom de « Vater Gleim » :
[…] So lange Vater Rhein
Von Zorn und Rache glüht
So lange singt er nicht, das schöne Rheinweinlied,
So lange trinkt er keinen Wein,
Der arme Vater Rhein!
[…] Aussi longtemps que notre fleuve-père, le Rhin
Brûlera de colère et de vengeance,
Il ne chantera pas, le beau chant du vin du Rhin
Il ne boira pas,
Votre pauvre « Vater Rhein » !
La poésie au service des causes déguisées.
Ce petit échantillon illustre l’usage possible de la poésie en faveur de la paix. Les odes est un genre littéraire connu dans l’antiquité en tant que discours prononcé pour célébrer la fin de la guerre et ainsi envisager une paix durable. Jusqu’au XVIIe siècle, un poème dédié à la paix se définissait comme un chef-d’œuvre rhétorique à la double gloire des puissants et des poètes. Le changement s’opère au XVIIIe siècle lorsque les poètes cessent de se mettre au-devant de la scène au profit de la cause commune qu’ils défendent. Les traités de paix sont alors accompagnés d’une production poétique fonctionnelle.
« Et « poésie » implique de donner un sens à cette conclusion de la paix. Dans la tradition du XVIIe siècle, donner un sens consistait souvent à affirmer que la paix serait envoyée par Dieu pour rétablir la justice divine sur la terre et sauver les hommes de leurs péchés. »
Mais les temps changent et la poésie n’est plus au service de la cause divine, mais celle de l’homme seul qui au travers des envolés poétiques se débat avec ses propres démons, dont le cœur balance entre l’esthétisme à l’adresse du monarque qui incarne les espoirs du peuple et le revanchardisme qui par l’intermédiaire de la guerre de papier incite à la va-t’en guerre.
Dans son expression allemande, la poésie était en voie de définir ses spécificités nationales en vue de la réunification de l’Allemagne moderne au XIXe siècle. Comme les frères Grimms, les Odes, les idylles et autres quatrains sont un puissant levier dans la construction de la conscience nationale en Allemagne. Tout comme dans le maintien de la conscience nationale polonaise par exemple en quête de recouvrement de son indépendance politique tout le long du XIXe siècle. Tous les pays du monde ont toujours fait ainsi, la voix des poètes est un levier puissant pour défendre la cause commune.
La journée de la poésie prévue par l’Unesco n’a pas pour but de célébrer l’émotion générée par la flore printanière. Derrière les mots se cache souvent un dure combat pour un monde meilleur, au moins pour quelques-uns.
La poésie dans la Bible
Le poème ou Father Gleim joue avec Vater Rhein, dans sa résonance est proche du Psaume 136 qui décrit de façon poignante le malheur des exilés de Jérusalem en Babilone.
“Sur les rives de Babylone… nous avons pendu nos harpes… nos geôliers nous demandaient : Jouez-nous des aires d’autrefois ! Comment pouvons-nous jouer sur une terre étrangère ? Non que ma langue colle à mon palais si je t’oublie, Jérusalem.” (Cité de mémoire)
Mais la clef de la poésie biblique se trouve dans l’échange entre Jésus et la Samaritaine au sujet de l’eau qui étanche la soif de l’esprit. Au cours de cet échange au puits de Jacob, Jésus glisse “Si tu savais le don de Dieu”. La poésie de la bible sert à aborder les dons spirituels.
A cause de cela, la poésie est présente partout dans la Bible. Comme un cerf, comme une biche je cherche de l’eau, je cherche de l’eau vive qui coule à flot et que l’on acquiert sans payer, car c’est un don gratuit. On paye éventuellement l’emballage, mais pas pour l’eau elle-même qui coule à flot dans le désert qui assoiffe.
Si Dieu a besoin de la poésie pour se dire, est-ce alors prendre au sérieux tout ce qui est raconté dans la Bible ? Comment considérons-nous la force de la poésie en général ? Et en particulier, celle qui est présente dans la Bible et celle qui se trouve dans tous les textes qui s’en inspirent ? Un passe-temps agréable, apaisant, nourrissant, ou au contraire un exercice inutile et ennuyeux et à ce titre impraticable pour l’esprit humain qui se respecte.
Nos prédispositions mentales sont pour quelque chose dans le rapport à la poésie. L’acceptation ou le rejet qui en résulte pour ne pas être polarisant s’enrichissent par des ne se prononce pas. Une neutralité bienveillante est toujours signe de la recherche de la relation apaisante. Sans dédaigner cela, ce n’est pas le terrain exclusif sur lequel chasse la poésie.
Pour terminer je me permets de citer un poème publié dans un recueil intitulé Les plumes que l’on assassine, c’est une commande de l’Éditeur qui a pris l’initiative de réagir de cette façon-là à la suite des attentats de janvier 2015 à Paris. Dans l’introduction le président de Flammes Vives a posé cette question :
“Qui d’autres que les poètes pouvaient le mieux exprimer l’indignation devant la sauvagerie des attentats de janvier 2015 ?”
Indignés qu’ils le sont, les poètes ne s’y arrêtent pas. Passer à l’action veut dire crier. Crier à mort et à la vie. Crier de douleur recueillie dans l’encrier et sur le papier.
CES PAROLES QU’ON ASSASSINE
La plume d’un littérateur s’échappa de sa main,
De la main lourdement posée sur l’écriture,
Le cœur léger, la plume est partie,
En échappant à la pensée nécrosée de son commanditaire,
Ne tirez pas sur moi, s’écria-t-elle,
Affolée par les signes d’en bas,
Ne tirez pas non plus sur la main,
Qui me retenait dans sa pensée,
Ne tirez pas ou alors tirez seulement sur moi,
Je suis si fragile et si légère
Même si vous m’atteignez
Je me démultiplierai à l’infini,
Parlez-moi,
Et je me mettrai entre vos mains
Pour dire la douleur qui est la vôtre.
Cette douleur sera aussi la mienne
Car elle s’écoulera dans mon encre
Et nous ne ferons plus qu’un !
p.93
Mais les véritables poètes sont les enfants, leur poésie est aussi naturelle que l’eau de source.
Je termine par citer une fillette qui dit à sa mère
« Maman, je t’aime plus haut que le ciel. »
Ainsi soit-il!