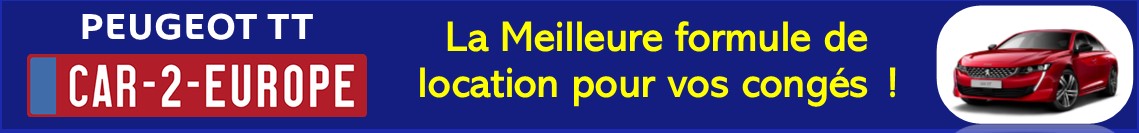S’expatrier n’est pas toujours définitif, et irrévocable.
Parfois, des opportunités se présentent, et le retour en France s’impose. Muriel et Raphaëlle sont mères de famille et ont suivi leur mari à l’étranger pendant plusieurs années. A l’été 2024, les deux familles ont quitté, respectivement, le Ghana et Singapour, avec leur mari et leurs enfants pour s’installer à Montpellier. Chacune a vécu le retour différemment. Ce qu’elles ont vécu s’appelle le choc culturel inversé. D’après Satinka Sansón, fondatrice de FeelBetter, les caractéristiques sont similaires à un deuil. “
Des récits d’histoires similaires remplissent nos bibliothèques et nos mémoires.
Je voudrais m’y attarder sur ceux trouvés dans ma mémoire vive. Je n’envisage pas de les raconter de manière crue. Le nom, la date, la force des vents contraires à l’atterrissage et après, la profondeur de l’émotion et son impact sur l’équilibre mental, la durée du mal-être, les conséquences sur l’entourage immédiat, le travail etc. Même la religion en prend un coup.
Non, mais j’envisage d’exposer de façon plus éparse et donc de façon moins identifiable les faits et la manière dont je m’en saisis. Sans pour autant vouloir dissimuler quoique ce soit. Tout en sachant que moi-même je suis partie prenante de cette présentation. Je puise aussi dans ma propre expérience dont certains souvenirs sont marqués des émotions qui restent toujours actives.
La description proposée est donc très parcellaire et orientée pour conduire le regard dans les va et vient entre l’ici et le là-bas. L’ici désigne l’endroit du départ et le là-bas est celui de l’arrivée. Au retour en France où le pays d’origine, ici devient là-bas et là-bas devient ici. Tout en sachant que la perception d’ici comme celle de là-bas, obéissent aux règles de projections constantes, j’aime, je n’aime pas. Le reste, c’est pour le décor.
Partir c’est bien
Sortir de son pays d’origine, le quitter pour aller ailleurs est comparable à ce qui arrive au poussin. Pour sortir de sa coquille, le poussin doit la casser de l’intérieur. La coquille qui le protégeait de sa conception durant sa croissance, dès à présent, s’il ne la quitte pas, elle devient un carcan qui va ligoter sa vie durant.
Si tout le monde ne quitte pas son pays pour aller ailleurs, tout le monde est obligé de passer par ce stade, rien que bougeant un peu ou accueillant dans le voisinage ou sa propre famille des étrangers. De ce point de vue, le faire à l’intérieur du pays où à l’extérieur y est secondaire. Le fait de partir à l’étranger renforce cette expérience d’étrangeté ressentie activement ou passivement, obtenue par une coupure culturelle souvent radicale.
Le pays d’origine aux dimensions de la famille, du village, du quartier, de la tribu, du pays, ou encore de la zone ethnique, linguistique, religieuse…
Sortir du pays d’origine pour partir à l’étranger, sortir de là où on avait grandi, c’est couper une seconde fois le cordon ombilical, celui qui relie cette fois-ci avec l’extérieur, avec les paysages et leurs animations. Les émotions générées par des paysages et leurs animations façonnent alors la sensibilité personnelle qui fait corps avec. Tous les poètes ou autres artistes savent la richesse de l’interdépendance qui existe entre l’être vivant et la nature qui l’entoure ou la nature qu’il trouve en lui-même, avec lesquelles il interagit constamment.
Cette interdépendance rend l’être humain disponible pour la création d’un espace de rencontre avec lui-même et ses semblables. Partir ailleurs, c’est rendre le territoire ainsi conquis disponible à la rencontre qui naît d’une vulnérabilité émotionnelle. La perle rare naît d’une telle vulnérabilité. Elle s’appelle l’amour, l’amitié ou les deux à la fois.
Le départ des ados de la maison familiale provoque la vulnérabilité émotionnelle chez tout le monde. Pourvu que rien de grave ne t‘arrive, on sera toujours là pour te soutenir, épauler et témoigner de notre amour. Évidemment des choses vont lui arriver et l’amour qui sauve ne sera pas toujours suffisamment présent pour prévenir du danger, ou même soigner les blessures.
Partir c’est risquer sa vie, c’est la mettre en jeu de quitte ou double, c’est la doter d’une assurance de précarité.
C’est la chérir ailleurs, autrement, mais toujours avec les mêmes moyens du bord, ceux embarqués dans le navire du corps marqué par des aspirations de voir ailleurs. Pour l’argent, pour l’amour, pour l’amour de l’argent, pour l’argent de l’amour. Pour s’accomplir, pour partager, pour réaliser des rêves et pour les corriger. Pour flotter dans le bien-être d’opulence douceâtre, pour naviguer à vue, pour s’arrêter à ne plus rien comprendre.
Malgré tout cela, pour la plupart du temps lorsque la nouvelle perspective se présente, l’interrogation sur le bien-fondé d’une telle décision bourgeonne, exhalant les parfums agréables aux narines bien de chez nous. Finalement, on s’est déjà si bien senti ici, que repartir de nouveau pour un prétendument mieux ailleurs n’est pas convaincant. La prise du large ne peut pas se faire sans la levée de l’ancre.
Parti de Pologne en 1980 pour la France, puis en 2012 pour Hong Kong, jeter l’ancre sur un nouveau fond de mer de mon existence s’accompagne d’une obligation de lever l’ancre de nouveau. Jusqu’à la levée définitive de l’ancre de la vie. Les vrais nomades le savent, même si cela leur coûte en termes de déménagements constants, effectués surtout dans leur tête. Lever le camp, évacuer le camp ou encore foutre le camp, ces locutions font partie d’un même segment sémantique, que l’on peut définir par le mot partir.
Il y a partir et partir.
Partir géographiquement pas très loin, juste dans le village voisin, ville voisine, pays voisin, c’est rester en lien direct avec le lieu d’origine, un englobant dans lequel on peut se reconnaître relativement facilement. Les similitudes éventuelles peuvent adoucir un peu la souffrance provoquée par le déracinement, par la coupure. Les transfrontaliers l’expérimentent : travail en Suisse, logement en France, vacances au Portugal.
L’instinct nomade n’a jamais quitté l’espèce humaine qui imite les oiseaux migrateurs pour passer l’hiver au chaud en Floride ou sur la côte d’Azur. Partir sur la Lune ou sur Mars etc, donc dans l’espace cosmique, c’est de savoir pertinemment que la loi de la gravité ne fonctionne plus là-haut et qu’il faut attacher la ceinture pour se sentir rassuré de flotter de façon maîtrisée.
Lorsque la différence culturelle avec sa barrière de langue est considérée tout au moins au début comme quasi totalement infranchissable, c’est la flottaison qui prend alors le relais de la marche sur la terre natale, celle des autres.
Arrivée en mode d’atterrissage d’urgence.
Flottante est l’attention à l’égard de l’autre qui communique dans sa langue maternelle que l’on ne maîtrise absolument pas. L’on ne capte même pas un centième de ce qui se communique entre les initiés. Être un spécimen rarissime dans un entourage professionnel local, se sentir un enfant pas comme les autres une fois parachuté dans un milieu scolaire à l’etranger qui de plus est international, prendre son envol tout en suivant le conjoint. Obéir à l’instinct pour réaliser à la fois sa vie et la mission confiée. Même si ce n’est pas comme pour les réfugiés fuyant les horreurs chez eux, l’atterrissage a toujours quelque chose de mécanique.
On aura beau tout faire pour que l’atterrissage se fasse le plus doucement possible, il ne peut jamais se faire à l’aide de pilote automatique, car celui-ci ne fonctionne que dans les conditions optimales. Or venir dans un nouvel endroit, excitant et prometteur qu’il soit, est toujours lié à l’expérience d’inconnu qui fait sortir d’un confort préalable. C’est l’expérience de la sortie d’Egypte pour le peuple de la promesse qui aura à batailler dur pour prendre possession de la terre promise, avant de comprendre que ce n’est sur cette montagne ou ailleurs que se trouve le trésor de la terre promise, mais dans le cœur humain.
Dans tout cela, il y a des flottaisons qui s’apparentent à l’atterrissage ou l’amarrage en mode d’urgence. Aucune préparation ne pourra jamais adoucir l’atterrissage ou l’amarrage de façon totalement indolore. Ou alors on évacue plus ou moins consciemment toute interrogation que la rencontre fait naître.
Est-ce possible?
Totalement?
J’ai du mal à l’imaginer.
En partie, certainement, on est tous un peu touchés par le syndrome négationniste qui apparaît dans toutes les projections qui par natures sont réductrices. Je ne comprends pas et cela ne m’apporte rien de l’essayer. Je sais ce que je veux, et je le fais savoir aux autres.
Le syndrome négationniste peut s’accompagner d’un autre, c’est qui est plus facile à concevoir, car nous sommes souvent touchés par le syndrome interventionniste. Comme dans le sketch de Pierre Palmade, sur le service militaire, dans lequel l’humoriste incarnant une jeune recrue se plaint devant l’adjudant des bruits causés par le clairon du matin, ce qui est bien dommageable car nuisible à la poursuite de sommeil si bien venu après une journée remplie d’exercices harassants qui ne servent à rien d’autre que occuper les pauvres garçons ainsi exploités qui se trouvent dans la caserne.
Trois petits enfants sont embarqués dans le bus avec la mère seule. Le mari travaille encore pour un temps ailleurs. Même si souvent c’est l’inverse, car c’est le mari qui vient en premier et la famille suit. La mère est équipée d’une poussette et d’un porte-siège pour la plus petite, la plus grande se débrouille pour ne pas se perdre. Une expérience douloureuse sur la route de l’Église. Aller, retour c’est au même prix pour cette expatriée parachutée dans un pays exotique certes, mais difficile à appréhender avec les standards connus dans d’autres sphères culturelles.
Une autre histoire surgit dans ma mémoire. Celle d’une famille arrivée à Hong Kong durant le covid (la faute à personne!). La mère est enceinte du quatrième, d’ailleurs elle va accoucher à la sortie de la quarantaine d’un mois. Il y a mieux comme atterrissage.
Et le dernier exemple est celui d’une jeune femme qui au bout de trois mois est rapatriée sanitaire en France. Elle est victime d’un syndrome d’agoraphobie, renforcé par l’oppression provoquée par l’environnement urbain très dense, trop dense pour elle.
Puisque tu pars
Une farewell en bonne et due forme, c’est quand on a le temps et les moyens. Sinon un départ en catimini sur la pointe de pieds pour déranger personne. Surtout quand la famille se trouve sous le mandat d’expulsion immédiate, disposant d’un délai de 24 heures pour quitter le territoire après la décision de la justice suite à l’usage de la drogue par le fiston qui s’est laissé prendre en flagrant délit de consommation. Souvent le délai est un peu plus long pour les malheureux qui prennent la porte pour cause de faute professionnelle réelle ou présumée.
Il y a aussi des départs provoqués par une décision visant le rapprochement avec la famille, les grands-parents et/ou les parents vieillissants, malades. L’éducation des enfants à assurer dans le contexte culturel à la française provoque aussi le retour en France. Et parfois un nouveau départ.
Dans cette présentation, ne sont pas prises en compte les migrations à l’étranger d’un endroit à l’autre en dehors de la France. Même si parfois un retour en France pour un peu de temps peut avoir lieu, auquel cas l’expérience du choc culturel inversé peut aussi avoir lieu.
Souvent la bonne préparation aide à adoucir le retour, sans pour autant éviter le choc culturel inversé, sans forcément parler d’un choc comparable à un deuil de quelqu’un qu’on déplore. Mais tout dépend de la constitution psychologique et de la capacité mentale à absorber le choc pour se réinventer dans cet ailleurs, celui de là-bas.
Comment c’est là bas?
Hong Kong nous manque, nos enfants sont déconnectés de leurs amis laissés, certains sont mal accueillis, alors que lorsque nous étions arrivés en expatriés leur intégration était facile, tout le monde vivait une situation similaire. Ma fille ne se sent pas bien accueillie, on la traite de chinoise sous prétexte que je suis d’origine chinoise par mes deux parents, mais ce n’est pas le cas de ma fille, car son père est un caucasien. Qu’est-ce que c’est dur pour elle, alors que si nous sommes rentrés en France c’était essentiellement pour lui permettre de renforcer son identité française qui nous est si importante. Combien de fois elle rentre d’école en pleurs en se sentant exclue, même par les profs. Pour survivre elle s’est liée d’amitié avec des camarades comme elle, venant de l’etranger, sauf que pour elle c’est un retour dans la ville ou elle était née.
Partir à la campagne pour prendre la retraite, c’est non seulement aspirer au calme, c’est aussi faire une coupure avec le mode de vie urbaine avec toutes les sollicitations, les facilités aussi. Se réinventer dans un ailleurs là-bas, alors qu’il était autrefois un ici, c’est accepter le deuil de deux du premier ici et du premier là-bas pour entrer dans ce second ici.
Le divorce avec mon mari m’a entraîné dans une spirale de douleur inexprimable. Il fallait faire le deuil du lieu ou nous étions pourtant si heureux et qui est devenu la terre de trahison. Il fallait faire le deuil d’une vie heureuse au retour en France, là où nous avons grandi, sans savoir à l’époque pour quoi faire. Lui, resté à l’etranger tranquille avec une autre moitié, alors que moi, désormais en mère célibataire rentrée au pays, je dois faire face à tant de problèmes, y compris financiers. Il gâte sa fille par les cadeaux dont il la couvre sans cesse pour étaler sa “puissance d’amour”. Alors qu’il me refuse la part de participation à l’éducation de l’enfant pour m’humilier et continuer à exercer la pression. Si j’ai accepté de me faire baptiser adulte, c’était pour entrer plus en profondeur dans sa culture religieuse qui lui semblait si indispensable. Je ne regrette pas ce choix car je découvre la douceur de l’Amour. Mais la pilule est difficile à avaler.
Je me suis un peu étendu sur cet exemple, mais malheureusement c’est ce qui arrive si souvent dans des configurations semblables. Les rêves d’une vie accomplie dont le bonheur est souvent brisé et le retour est d’autant plus délicat.
Mais, il y a tant de situations ou les choses se passent bien plus positivement. La solidité des couples étant bien prouvée, parfois elle se renforce même à l’occasion des épreuves, ce qui est tout à fait naturel.
Comme avant l’expatriation, savoir avec qui partager la préparation, au retour la question de savoir avec qui partager ce que l’on a vécu là-bas est tout à fait légitime, mais pas facilement réalisable. Les objets ramenés comme trophées des voyages découverts, parlent à quelques-uns, restent indifférents voire indisposent d’autres. En leur présence, il reste à leur propriétaire l’occasion d’une simple méditation sur les bénéfices et les leçons tirées et toujours à tirer de la vie là-bas.
Comme tout le monde ou presque (sauf pour ceux qui sont surpris par l’arrêt de vie de leur corps en expatriation, à l’étranger), j’envisage depuis quelques années déjà de quitter Hong Kong et rentrer en France, en Pologne, ailleurs?
Les deux groupes whatsapp que j’avais créé pour communiquer ces podcasts est une manière de faire le lien avec les anciens de Hong Kong ou d’ailleurs.
Quel plaisir de retrouver des anciens et de voir comment ils arrivent à se réinventer au retour au pays. Un peu de difficulté mais avant tout beaucoup de joie de voir les enfants grandir dans un pays ou il est bon de vivre.
——————————-
Récits.
Écrit par Léa Degay
Muriel, son mari et leurs quatre enfants ont passé cinq années au Ghana avant de rentrer en France, il y a six mois. Un retour que la famille n’avait pas choisi, et qui s’est avéré plus difficile que prévu. “Nous serions bien rentrés en France un peu plus tard”, confie Muriel. L’opportunité de poursuivre l’expatriation dans un autre pays ne s’étant pas présentée dans les conditions souhaitées, la famille s’est installée à Montpellier.
A l’inverse, Raphaëlle et sa famille n’étaient pas à leur première expatriation. Après avoir vécu cinq ans en Russie, trois ans en Pologne et un premier retour en France, ils sont repartis à Singapour pour deux ans avant de rentrer à l’été 2024. Ce retour à la vie française, loin d’être une épreuve, s’est avéré une transition fluide et réfléchie.
Chaque retour d’expatriation est unique et propre à chacun.
Deux retours d’expatriation, deux expériences différentes. La raison est simple : chaque expatriation est unique. “Tout dépend des motivations du départ et du retour. Certains expatriés reviennent convaincus d’avoir fait le bon choix, mais se heurtent à une réalité désillusionnante. D’autres ont quitté leur pays d’expatriation à contre-cœur et ressentent un manque profond. Souvent, le retour a été organisé de manière logistique (logement, école, travail) sans préparer l’impact émotionnel, ce qui renforce le choc”, explique Satinka Sanson, fondatrice de FeelBetter.
C’est exactement ce qu’il s’est passé pour Muriel et sa famille. D’un point de vue administratif, tout a été soigneusement anticipé. Mais l’aspect psychologique a été largement sous-estimé. “Nous savions que ce serait dur. D’autres familles expatriées nous avaient averti, ils nous disaient : le premier retour est plus difficile à vivre. Mais nous n’aurions pas imaginé à ce point. Il nous aurait fallu plus de retours d’expérience détaillés pour s’y préparer.”
D’ailleurs, le retour a été vécu très différemment selon les membres de la famille. Leur aîné, entré en collège, a rapidement trouvé ses marques, gagnant en autonomie. Mais pour les trois plus jeunes, la transition s’est révélée plus compliquée. “Ils regrettent vraiment de ne plus être au Ghana. Ils y ont vécu toute leur vie, et n’avaient presque aucun souvenir de la France en dehors des vacances.” L’un des aspects les plus difficiles du retour en France a été la sensation de perte de liberté. “Au Ghana, tout était plus simple. Ici, tout est régi par des règles. Nos enfants le vivent très mal.”
Qu’est-ce qu’un choc culturel ?
Il s’agit de la difficulté d’adaptation à un pays étranger. Mais le retour dans son pays d’origine peut être tout aussi déstabilisant. Ce phénomène, appelé choc culturel inversé, touche de nombreux expatriés qui, après des années passées à l’étranger, ressentent un profond sentiment de décalage en rentrant “chez eux”.
L’expatriation comme une parenthèse pour Raphaëlle et sa famille
Dès le départ pour Singapour, Raphaëlle et son mari savaient qu’ils ne resteraient pas longtemps. Ils envisageaient trois ans, mais une opportunité professionnelle s’est présentée pour son mari au bout de deux ans, rendant la décision de rentrer en France évidente. “Nous savions que le retour n’est pas toujours simple et que les gens ne sont pas forcément heureux dans leur emploi après une expatriation. Nous étions déjà rentrés d’expatriation quelques années plus tôt. Alors quand mon mari a trouvé quelque chose qui cochait toutes les cases, nous avons foncé.” En rentrant à l’été 2024, la famille choisit de poser ses valises à Montpellier. Une ville inconnue pour eux, mais qui les enthousiasmait par sa qualité de vie et son climat.
L’incompréhension des proches et le fossé culturel
Un autre phénomène qui accentue le choc culturel inversé est l’incompréhension de l’extérieur. En revenant, Muriel et son mari ont été frappés par le manque d’intérêt de leur entourage pour leur vie à l’étranger : “Nos amis ne nous ont posé aucune question sur nos années passées au Ghana ni même sur notre retour en France”.
Sans le vouloir ni s’en rendre compte, l’entourage amical de Raphaëlle n’est composé majoritairement d’anciens expatriés : “Nous nous comprenons et pouvons discuter plus librement de ce que nous traversons”.
“Seules les personnes ayant vécu une expatriation comprennent vraiment ce que nous traversions.”
Se sentir en décalage avec ses proches, avoir l’impression d’être un étranger dans son propre pays, ces ressentis peuvent entraîner une déstabilisation identitaire. Les expatriés revenus éprouvent parfois de la honte à parler de leur mal-être, se renferment et peuvent voir leurs relations se dégrader. Un entourage qui ne comprend pas ce qu’ils vivent, renforce cet isolement.
Malgré ces difficultés, la famille de Muriel commence peu à peu à trouver ses marques en France. Mais leur expérience illustre à quel point le retour d’expatriation peut être un véritable défi, tant sur le plan émotionnel que social. Et Raphaëlle le reconnaît : “J’avais déjà connu un premier retour d’expatriation, donc je savais ce qu’il fallait éviter. Cela m’a aidé à ne pas commettre les mêmes erreurs. Si notre retour s’est passé en douceur, c’est en grande partie grâce à une préparation intensive”.
Selon Satinka Sanson, le choc culturel inversé se manifeste souvent par des émotions comparables à celles du deuil. En premier le déni et la déception, l’expatrié n’a pas anticipé que son pays natal et ses proches aient changé en son absence. Ensuite, la comparaison constante, l’expatrié oscille entre son pays d’avant et son pays actuel, sans parvenir à trouver sa place. Enfin, la dépression, la colère et la frustration, ce décalage génère une sensation d’étrangeté et un manque de repères, avec des répercussions sur le bien-être mental.
Comme pour tout, il faut un temps de (ré)adaptation : “Il faut compter au minimum six mois après le retour, pour commencer à se sentir à sa place”. La fondatrice de Feelbetter rassure cependant les fraîchement rentrés en France : “chacun est différent, il n’y a pas de date de prescription et cela peut durer plus ou moins longtemps”. Néanmoins, si ces symptômes persistent, un accompagnement psychologique peut s’avérer nécessaire pour éviter un mal-être profond.
Et Raphaëlle de conclure : lorsque vous décidez de rentrer en France, “il faut y aller à fond, activer les contacts, rejoindre les groupes Facebook et WhatsApp adaptés, et prévoir tout en amont”.